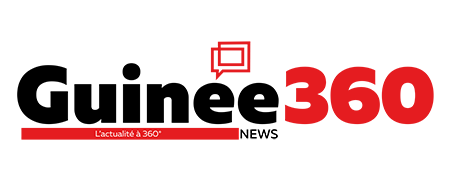Face à la montée de la contestation, le président malgache Andry Rajoelina a annoncé, lundi 29 septembre au soir, la dissolution de son gouvernement.
C’est une décision prise alors que des milliers de manifestants continuaient de défiler dans plusieurs villes du pays, dont la capitale Antananarivo, où la police a eu recours à des grenades lacrymogènes pour disperser des foules majoritairement composées de jeunes réclamant la démission du chef de l’État.
Au moins 22 personnes ont perdu la vie et plus d’une centaine ont été blessées, selon le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme, rapporte l’AFP citée par France 24. Son responsable, Volker Türk, précise que les victimes comptent à la fois des manifestants et des passants touchés par les forces de sécurité, ainsi que des personnes tuées lors de violences et de pillages attribués à des bandes criminelles sans lien direct avec le mouvement.
Le Haut-Commissaire s’est déclaré « profondément attristé » par ces pertes humaines et a exhorté les autorités malgaches à mener des enquêtes « rapides, indépendantes et transparentes » afin d’identifier et sanctionner les responsables.
Ces événements s’inscrivent dans une longue histoire de contestations à Madagascar. Depuis son indépendance en 1960, le pays, l’un des plus pauvres du monde, a connu à plusieurs reprises des soulèvements populaires contre le pouvoir en place, dont celui de 2009 qui avait conduit à la chute du président Marc Ravalomanana.
 La mobilisation actuelle, lancée jeudi dernier et largement relayée via les réseaux sociaux par un mouvement baptisé Gen Z, ne se limite plus aux revendications liées aux coupures récurrentes d’eau et d’électricité. Elle traduit désormais un rejet plus large du régime en place et une demande explicite de changement politique.
La mobilisation actuelle, lancée jeudi dernier et largement relayée via les réseaux sociaux par un mouvement baptisé Gen Z, ne se limite plus aux revendications liées aux coupures récurrentes d’eau et d’électricité. Elle traduit désormais un rejet plus large du régime en place et une demande explicite de changement politique.